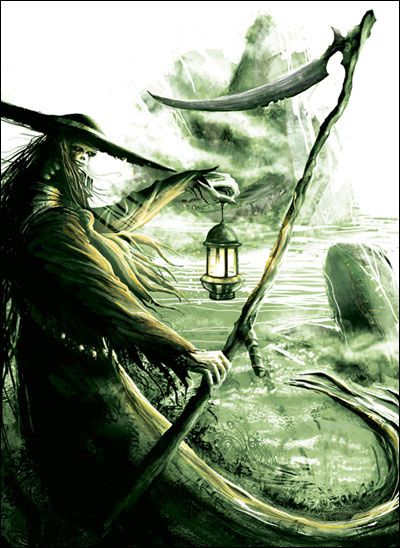Une légende parmis plein d'autre qui nous viens de Brocéliande, une terre, une forée qui nous cache bien des mystére.
Kement-man oa d’ann amzer
Ma ho devoa dennt ar ier.
Il était une fois, deux pauvres gens, mari et femme, qui avaient sept enfants, six garçons et une fille. Le plus jeune des garçons, Yvon, et la fille Yvonne, étaient un peu pauvres d’esprit, ou
du moins le paraissaient, et leurs frères leur faisaient toutes sortes de misères. La pauvre Yvonne en était toute triste, et ne riait presque jamais. Tous les matins, ses frères l’envoyaient
garder les vaches et les moutons, sur une grande lande, avec un morceau de pain d’orge ou une galette de blé noir pour toute pitance, et elle ne revenait que le soir, au coucher du soleil. Un
matin que, selon son habitude, elle conduisait ses vaches et ses moutons au pâturage, elle rencontra en son chemin un jeune homme si beau et si brillant qu’elle crut voir le soleil en personne.
Et le jeune homme s’avança vers elle et lui demanda :
— Voudriez-vous vous marier avec moi, jeune fille ?
Voilà Yvonne bien étonnée et bien embarrassée de savoir que répondre.
— Je ne sais pas, dit-elle, en baissant les yeux ; on me fait assez mauvaise vie, à la maison.
— Eh bien ! Réfléchissez-y, et demain matin, à la même heure, je me retrouverai ici, quand vous passerez, pour avoir votre réponse.
Et le beau jeune homme disparut, alors. Toute la journée, la jeune fille ne fit que rêver de lui. Au coucher du soleil, elle revint à la maison, chassant devant elle son troupeau et chantant
gaîment. Tout le monde en fut étonné, et l’on se demandait :
— Qu’est-il donc arrivé à Yvonne, pour chanter de la sorte ?
Quand elle eut rentré ses vaches et ses moutons à l’étable, elle se rendit auprès de sa mère, et lui conta son aventure et demanda ce qu’elle devait répondre, le
lendemain.
— Pauvre sotte ! Lui dit sa mère, quel conte me faites-vous là ? Et puis, pourquoi songer à vous marier, pour être malheureuse ?
— Je ne le serai jamais plus qu’à présent, ma mère. Sa mère haussa les épaules, et lui tourna le dos.
Le lendemain matin, aussitôt le soleil levé, Yvonne se rendit, comme à l’ordinaire, à la grand’lande, avec ses vaches et ses moutons. Elle rencontra, au même endroit que la veille, le beau jeune
homme, qui lui demanda encore :
— Eh bien ! Mon enfant, voulez-vous être ma femme ?
— Je le veux bien, répondit-elle, en rougissant.
— Alors, je vais vous accompagner jusque chez vos parents, pour demander leur consentement.
Et il alla avec elle chez ses parents. Le père et la mère et les frères aussi furent étonnés de voir un si beau prince, et si richement paré, vouloir épouser la pauvre bergère, et personne ne
songea à dire non.
— Mais, qui êtes-vous aussi ? demanda pourtant la mère.
— Vous le saurez, le jour du mariage, répondit le prince.
On fixa un jour pour la cérémonie et le prince partit, alors, laissant tout le monde dans le plus grand étonnement, et l’on s’occupa des préparatifs de la noce.
Au jour convenu, le prince vint, avec un garçon d’honneur presque aussi beau que lui. Ils étaient montés sur un beau char doré, attelé de quatre magnifiques chevaux blancs ; et ils étaient si
parés et si brillants, eux et leur char et leurs chevaux, qu’ils éclairaient tout, sur leur passage, comme le soleil.
Les noces furent célébrées avec beaucoup de pompe et de solennité, et, en se levant de table, le prince dit à la nouvelle mariée de monter sur son char, pour qu’il la conduisît à son palais.
Yvonne demanda un peu de répit, afin d’emporter quelques vêtements.
— C’est inutile, lui dit le prince, vous en trouverez à discrétion, dans mon palais.
Et elle monta sur le char, à côté de son mari. Au moment de partir, ses frères demandèrent :
— Quand nous voudrons faire visite à notre soeur, où pourrons-nous la voir ?
— Au Château de Cristal, de l’autre côté de la Mer Noire, répondit le prince. Et il partit aussitôt.
Environ un an après, comme les six frères n’avaient aucune nouvelle de leur sœur, et qu’ils étaient curieux de savoir comment elle se trouvait avec son mari, ils résolurent d’aller à sa
recherche. Les cinq aînés montèrent donc sur de beaux chevaux et se mirent en route. Leur jeune frère Yvon voulut aussi les accompagner, mais ils le forcèrent à rester à la maison.
Ils marchaient, ils marchaient, toujours du côté du soleil levant, et demandant partout des nouvelles du Château de Cristal. Mais, personne ne savait où se trouvait le Château de Cristal. Enfin,
après avoir parcouru beaucoup de pays, ils arrivèrent un jour sur la lisière d’une grande forêt, qui avait au moins cinquante lieues de circonférence. Ils demandèrent à un vieux bûcheron qu’ils
rencontrèrent s’il ne pouvait pas leur indiquer la route pour aller au Château de Cristal. Le bûcheron leur répondit : — Il y a dans la forêt une grande allée que l’on appelle l’allée du Château
de Cristal, et peut-être conduit-elle au château dont vous parlez, car je n’y suis jamais allé.
Les cinq frères entrèrent dans la forêt. Ils n’étaient pas allés loin, qu’ils entendirent un grand bruit, au-dessus de leurs têtes, comme d’un orage passant sur les cimes des arbres, avec du
tonnerre et des éclairs. Ils en furent effrayés, et leurs chevaux aussi, au point qu’ils eurent beaucoup de peine à les maintenir. Mais, le bruit et les éclairs cessèrent bientôt, et ils
continuèrent leur route. La nuit approchait, et ils étaient inquiets, car la forêt abondait en bêtes fauves de toute sorte. Un
d’eux monta sur un arbre, pour voir s’il n’apercevrait pas le Château de Cristal, ou quelque autre habitation.
— Que vois-tu ? Lui demandèrent ses frères, d’en bas.
— Je ne vois que du bois, du bois…. de tous les côtés, au loin, au loin !…
Il descendit de l’arbre, et ils se remirent en marche. Mais, la nuit survint, et ils ne voyaient plus pour se diriger dans la forêt. Un d’eux monta encore sur un arbre.
— Que vois-tu ? Lui demandèrent ses frères.
— Je vois un grand feu, là-bas !
— Jette ton chapeau dans la direction du feu, et descends.
Et ils se remirent en route, dans la direction où était le feu, persuadés qu’il devait y avoir là quelque habitation humaine. Mais, bientôt ils entendirent encore un grand bruit, au-dessus de
leurs têtes, beaucoup plus grand que la première fois. Les arbres s’entrechoquaient et craquaient, et des branches cassées et des éclats de bois tombaient à terre, de tous côtés. Et du tonnerre !
Et des éclairs !… c’était effrayant !… Puis, tout d’un coup, le silence se rétablit, et la nuit redevint calme et sereine.
Ils reprirent leur marche, et arrivèrent au feu qu’ils cherchaient. Une vieille femme, aux dents longues et branlantes, et toute barbue, l’entretenait, en y jetant force bois. Ils s’avancèrent
jusqu’à elle, et l’aîné d’entre eux lui parla de la sorte :
— Bonsoir, grand’mère ? Pourriez-vous nous enseigner le chemin pour aller au Château de Cristal ?
— Oui vraiment, mes enfants, je sais où est le Château de Cristal, répondit la vieille ; mais, attendez ici jusqu’à ce que mon fils aîné soit rentré, et celui-là vous donnera des nouvelles toutes
fraîches du Château de Cristal, car il y va tous les jours. Il est en voyage, pour le moment, mais, il ne tardera pas à rentrer. Peut-être même l’avez-vous vu, dans la forêt ?
— Nous n’avons vu personne, dans la forêt, grand’mère.
— Vous avez dû l’entendre, alors, car on l’entend ordinairement où il passe, celui-là….Tenez ! Le voilà qui arrive : l’entendez-vous ?
Et ils entendirent, en effet, un vacarme pareil à celui qu’ils avaient entendu deux fois, dans la forêt, mais plus effrayant encore.
— Cachez-vous, vite, là, sous les branches d’arbres, leur dit la vieille, car mon fils, quand il rentre, a toujours grand’faim, et je crains qu’il ne veuille vous manger.
Les cinq frères se cachèrent de leur mieux, et un géant descendit du ciel, et, dès qu’il eut touché la terre, il se mit à flairer l’air et dit :
— Il y a ici odeur de chrétien, mère, et il faut que j’en mange, car j’ai grand’faim !
La vieille prit un gros bâton, et, le montrant au géant : — « Vous voulez toujours tout manger, vous ! Mais, gare à mon bâton, si vous faites le moindre mal à mes neveux, les fils de ma sœur, des
enfants si gentils et si sages, qui sont venus me voir. »
Le géant trembla de peur, à la menace de la vieille, et promit de ne pas faire de mal à ses cousins.
Alors, la vieille dit aux cinq frères qu’ils pouvaient se montrer, et les présenta à son fils, qui dit :
— Ils sont bien gentils, c’est vrai, mes cousins, mais, comme ils sont petits, mère !
Enfin, en leur qualité de cousins, il voulut bien ne pas les manger.
— Non seulement vous ne leur ferez pas de mal, mais, il faut encore que vous leur rendiez service, lui dit sa mère.
— Quel service faut-il donc que je leur rende ?
— Il faut que vous les conduisiez au Château de Cristal, où ils veulent aller voir leur sœur.
— Je ne puis pas les conduire jusqu’au Château de Cristal, mais, je les conduirai volontiers un bon bout de chemin, et les mettrai sur la bonne voie.
— Merci, cousin, nous n’en demandons pas davantage, dirent les cinq frères.
— Eh bien ! Couchez-vous là, près du feu, et dormez, car il faut que nous partions demain matin, de bonne heure. Je vous éveillerai, quand le moment sera venu.
Les cinq frères se couchèrent dans leurs manteaux, autour du feu, et feignirent de dormir ; mais, ils ne dormaient pas, car ils n’osaient pas trop se fier à la promesse de leur cousin le géant.
Celui-ci se mit, alors, à souper, et il avalait un mouton à chaque bouchée.
Vers minuit, il éveilla les cinq frères et leur dit :
— Allons ! Debout, cousins ; il est temps de partir !
Il étendit un grand drap noir sur la terre, près du feu, et dit aux cinq frères de se mettre dessus, montés sur leurs chevaux. Ce qu’ils firent. Alors, le géant entra dans le feu, et sa mère y
jeta force bois, pour l’alimenter. A mesure que le feu augmentait, les frères entendaient s’élever graduellement un bruit pareil à celui qu’ils avaient entendu dans la forêt, en venant, et, peu à
peu, le drap sur lequel ils étaient se soulevait de terre, avec eux et leurs chevaux. Quand les habits du géant furent consumés, il s’éleva dans l’air, sous la forme d’une énorme boule de feu. Le
drap noir s’éleva aussi à sa suite, emportant les cinq frères et leurs chevaux, et les voilà de voyager ensemble, à travers Pair. Au bout de quelque temps, le drap noir, avec les cinq, frères et
leurs chevaux, fut déposé sur une grande plaine. Une moitié de cette plaine était aride et brûlée, et l’autre moitié était fertile et couverte d’herbe haute et grasse. Dans la partie aride et
brûlée de la plaine, il y avait un troupeau de chevaux, gras, luisants et pleins
d’ardeur ; au contraire, dans la partie où l’herbe était abondante et grasse, on voyait un autre troupeau de chevaux maigres, décharnés et se soutenant à peine sur leurs jambes. Et ils se
battaient et cherchaient à se manger réciproquement.
Le géant, ou la boule de feu, avait poursuivi sa route, après avoir déposé les frères sur cette plaine, et il leur avait
dit :
— Vous êtes là sur la bonne voie pour aller au Château de Cristal ; tâchez de vous en tirer, à présent, de votre mieux, car je ne puis vous conduire plus loin.
Leurs chevaux étaient morts en touchant la terre, de sorte qu’ils se trouvaient, à présent, à pied. Ils essayèrent d’abord de prendre chacun un des beaux chevaux qu’ils voyaient dans la partie
aride de la plaine ; mais, ils ne purent jamais en venir à bout. Ils se rabattirent, alors, sur les chevaux maigres et décharnés, en prirent chacun un, et montèrent dessus. Mais, les chevaux les
emportèrent parmi les ajoncs et les broussailles qui couvraient une partie de la plaine, et les jetèrent à terre, tout meurtris et sanglants. Les voilà bien embarrassés ! Que faire ?
— Retournons à la maison, nous n’arriverons jamais à ce château maudit, dit un d’eux.
— C’est, en effet, ce que nous avons de mieux à faire, répondirent les autres.
Et ils retournèrent sur leurs pas ; mais, ils évitèrent de repasser par l’endroit où ils avaient rencontré la vieille femme qui entretenait le feu, et le géant son fils.
Ils arrivèrent enfin à la maison, après beaucoup de mal et de fatigue, et racontèrent tout ce qui leur était arrivé, dans leur voyage. Leur jeune frère Yvon était, selon son ordinaire, assis sur
un galet rond, au coin du foyer, et, quand il entendit le récit de leurs aventures et tout le mal qu’ils avaient eu, sans pourtant réussir à voir leur sœur, il dit :
— Moi, je veux aussi tenter l’aventure, à mon tour, et, je ne reviendrai pas à la maison sans avoir vu ma sœur Yvonne.
— Toi, imbécile ! Lui dirent ses frères, en haussant les épaules.
— Oui, moi, et je verrai ma sœur Yvonne, vous dis-je, en quelque lieu qu’elle soit.
On lui donna un vieux cheval fourbu, une vraie rosse, et il partit, seul.
Il suivit la même route que ses frères, se dirigeant toujours du côté du soleil levant, arriva aussi à la forêt et, à l’entrée de l’avenue du Château de Cristal, il rencontra une vieille femme
qui lui demanda :
— Où allez-vous ainsi, mon enfant ?
— Au Château de Cristal, grand’mère, pour voir ma sœur.
— Eh bien ! Mon enfant, n’allez pas par ce chemin-là, mais par celui-ci, jusqu’à ce que vous arriviez à une grande plaine ; alors, vous suivrez la lisière de cette plaine, jusqu’à ce que vous
voyiez une route dont la terre est noire. Prenez cette route-là, et, quoi qu’il arrive, quoi que vous puissiez voir ou entendre, quand bien même le chemin serait plein de feu, ne vous effrayez de
rien, marchez toujours droit devant vous, et vous arriverez au Château de Cristal, et vous verrez votre sœur.
— Merci, grand’mère, répondit Yvon, et il s’engagea dans le chemin que lui montra la vieille.
Il arriva, sans tarder, à la plaine dont elle lui avait parlé, et la côtoya tout du long, jusqu’à ce qu’il vît la route à la terre noire. Il voulut la prendre, suivant le conseil de la vieille,
mais, elle était remplie, à l’entrée, de serpents entrelacés, de sorte qu’il eut peur et hésita un moment. Son cheval lui-même reculait d’horreur, quand il voulait le pousser dans ce chemin.
Comment faire ? Se dit-il ; on m’a pourtant dit qu’il fallait passer par là !
Il enfonça ses éperons dans les flancs de son cheval, et il entra dans la route aux serpents et à la terre noire. Mais, aussitôt, les serpents s’enroulèrent autour des jambes de l’animal, le
mordirent, et il tomba mort sur la place. Voilà le pauvre Yvon à pied, au milieu de ces hideux reptiles, qui sifflaient et se dressaient menaçants autour de lui. Mais, il ne perdit pas courage
pour cela ; il continua de marcher, et arriva enfin à l’autre extrémité de la route, sans avoir éprouvé aucun mal. Il en fut quitte pour la peur.
Il se trouva, alors, au bord d’un grand étang, et il ne voyait aucune barque pour passer de l’autre côté, et il ne savait pas nager, de sorte qu’il était encore fort embarrassé. — « Comment faire
? Se disait-il ; je ne veux pourtant pas retourner sur mes pas ; j’essayerai de passer, arrive que pourra. »
Et il entra résolument dans l’eau. Il en eut d’abord jusqu’aux genoux, puis jusqu’aux aisselles, puis jusqu’au menton, et enfin par-dessus la tête. Il continua d’avancer, malgré tout, et finit
par arriver, sans mal, de l’autre côté de l’étang.
En sortant de l’eau, il se trouve à l’entrée d’un chemin profond, étroit et sombre et rempli d’épines et de ronces qui allaient d’un bord à l’autre de la route, et avaient racine en terre des
deux bouts. — « Je ne pourrai jamais passer par là, se disait-il. » Il ne désespéra pourtant pas. Il se glissa, à quatre pattes, par-dessous les ronces, rampa comme une couleuvre et finit par
passer. Dans quel état, hélas ! Son corps était tout déchiré et tout sanglant, et il n’avait plus le moindre lambeau de vêtement sur lui. Mais, il avait passé, malgré tout.
Un peu plus loin, il vit venir à lui, au grand galop, un cheval maigre et décharné. Le cheval, arrivé près de lui, s’arrêta comme pour l’inviter à monter sur son dos. Il reconnut alors que
c’était son propre cheval, qu’il avait cru mort. Il lui témoigna beaucoup de joie de le retrouver en vie, et monta sur son dos en lui disant : — « Mille bénédictions sur toi, mon pauvre animal,
car je suis rendu de fatigue. Je n’en puis plus. »
Ils continuèrent leur route, et arrivèrent alors à un endroit où il y avait un grand rocher, placé sur deux autres grands rochers. Le cheval frappa du pied le rocher de dessus, qui bascula
aussitôt et laissa voir l’entrée d’un souterrain, et il entendit une voix qui en sortit, et dit : — « Descends de ton cheval, et entre. »
Il obéit à la voix, descendit de cheval et entra dans le souterrain. Il fut d’abord suffoqué par une odeur insupportable, une odeur de reptiles venimeux de toute sorte. Le souterrain était, de
plus, fort obscur, et il ne pouvait avancer qu’à tâtons. Au bout de quelques moments, il entendit derrière lui un vacarme épouvantable, comme si une légion de démons s’avançait sur lui. Il
faudra, sans doute, mourir ici, pensa-t-il. Il continua, pourtant, d’avancer de son mieux. Il vit enfin poindre devant lui une petite lumière, et cela lui donna du courage. Le vacarme allait
toujours croissant, derrière lui, et approchant. Mais, la lumière aussi grandissait, à mesure qu’il s’avançait vers elle. Enfin, il sortit sain et sauf du souterrain…
Il se trouva alors dans un carrefour, et il fut encore embarrassé. Quel chemin prendre ? Il suivit celui qui faisait face au souterrain, et continua d’aller tout droit devant lui. Il y avait
beaucoup de barrières sur ce chemin, hautes et difficiles à franchir. Ne pouvant les ouvrir, il grimpait sur les poteaux, et passait par-dessus. La route allait, à présent, en descendant, et, à
l’extrémité, tout lui paraissait être de cristal. Il voyait un château de cristal, un ciel de cristal, un soleil de cristal, enfin tout ce qu’il voyait était de cristal. — « C’est dans un château
de cristal qu’on m’a dit que ma sœur demeure, et j’approche, sans doute, du terme de mon voyage et de mes peines, car voilà bien un château de cristal, » — se dit-il avec joie.
Le voilà près du château. Il était si beau, si resplendissant de lumière, que ses yeux en étaient éblouis. Il entra dans la cour. Comme tout était beau et brillant, par-là ! Il voit un grand
nombre de portes sur le château ; mais, elles sont toutes fermées. Il parvient à se glisser dans une cave, par un soupirail, puis, de là, il monte et se trouve dans une grande salle, magnifique
et resplendissante de lumière. Six portes donnent sur cette salle, et elles s’ouvrent d’elles-mêmes, dès qu’il les touche. De cette première salle, il passe dans une seconde, plus belle encore.
Trois autres portes sont à la suite les unes des autres, donnant sur trois autres salles, toutes plus belles les unes que les autres. Dans la dernière salle, il voit sa sœur endormie sur un beau
lit. Il reste quelque temps à la regarder, immobile d*admiration, tant il la trouve belle. Mais, elle ne s’éveillait pas, et le soir vint. Alors, il entend comme le bruit des pas de quelqu’un qui
vient et fait résonner des grelots, à chaque pas. Puis, il voit entrer un beau jeune homme, qui va droit au lit sur lequel était couchée Yvonne, et lui donne trois soufflets retentissants.
Pourtant, elle ne s’éveille ni ne bouge. Alors, le beau jeune homme se couche aussi sur le lit, à côté d’elle. Voilà Yvon bien embarrassé, ne sachant s’il doit s’en aller ou rester. Il se décide
à rester, car il lui paraît que cet homme traite sa sœur d’une singulière façon. Le jeune mari s’endort aussi à côté de sa femme. Ce qui étonne encore Yvon, c’est qu’il n’entend pas le moindre
bruit dans le château, et qu’il paraît qu’on n’y mange pas. Lui-même, qui était arrivé avec un grand appétit, n’en a plus du tout, à présent. La nuit se passe dans le plus profond silence. Au
point du jour, le mari d’Yvonne s’éveille et donne encore à sa femme trois soufflets retentissants. Mais, elle ne paraît pas s’en apercevoir, et ne s’éveille toujours pas. Puis il part
aussitôt.
Tout cela étonnait fort Yvon, toujours silencieux, dans son coin. Il craignait que sa sœur ne fût morte. Il se décida enfin, pour s’en assurer, à lui donner un baiser. Elle s’éveilla alors,
ouvrit les yeux et s’écria, en voyant son frère près d’elle :
— Oh ! Que j’ai de joie de te revoir, mon frère chéri !
Et ils s’embrassèrent tendrement. Alors Yvon demanda à Yvonne :
— Et ton mari, où est-il, sœur chérie ?
— Il est parti en voyage, frère chéri.
— Est-ce qu’il y a longtemps qu’il n’a pas été à la maison ?
— Non, vraiment, il n’y a pas longtemps, frère chéri ; il vient de partir, il n’y a qu’un moment.
— Comment, est-ce que tu ne serais pas heureuse avec lui, ma pauvre sœur ?
— Je suis très heureuse avec lui, frère chéri.
— Je l’ai pourtant vu te donner trois bons soufflets, hier soir, en arrivant, et trois autres, ce matin, avant de partir.
— Que dis-tu là, frère chéri ? Des soufflets !… C’est des baisers qu’il me donne, le soir et le matin.
— De singuliers baisers, ma foi ! Mais, puisque tu ne t’en plains pas, après tout… Comment, mais on ne mange donc jamais ici ?
— Depuis que je suis ici, mon frère chéri, je n’ai jamais éprouvé ni faim, ni soif, ni froid, ni chaud, ni aucun besoin, ni aucune contrariété. Est-ce que tu as faim, toi ?
— Non, vraiment, et c*est ce qui m’étonne. Est-ce qu’il n’y a que toi et ton mari dans ce beau château ?
— Oh ! Si. Nous sommes nombreux ici, mon frère chéri. Quand je suis arrivée, j’ai vu tous ceux qui y sont ; mais, depuis, je ne les ai jamais revus, parce que je leur avais parlé, quoiqu’on me
l’eût défendu.
Ils passèrent la journée ensemble, à se promener par le château et à causer de leurs parents, de leur pays et d’autres choses. Le soir, le mari d’Yvonne arriva, à son heure ordinaire. Il reconnut
son beau-frère, et témoigna de la joie de le revoir.
— Vous êtes donc venu nous voir, beau-frère ? Lui dit-il.
— Oui, beau-frère, et ce n’est pas sans beaucoup de mal.
— Je le crois, car tout le monde ne peut pas venir jusqu’ici ; mais, vous retournerez à la maison plus facilement : je vous ferai passer les mauvais chemins.
Yvon resta quelques’ jours avec sa sœur. Son beau-frère partait, tous les matins, sans dire où il allait, et était absent durant tout le jour. Yvon, intrigué par cette conduite, demanda, un jour,
à sa sœur :
— Où donc va ton mari ainsi, tous les matins ? Quel métier a-t-il aussi ?
— Je ne sais pas, mon frère chéri ; il ne m’en a jamais rien dit. Il est vrai que je ne le lui ai pas demandé aussi.
— Eh bien ! Moi, j’ai envie de lui demander de me permettre de l’accompagner, car je suis curieux de savoir où il va ainsi, tous les jours.
— Oui, demande-le-lui, mon frère chéri.
Le lendemain matin, au moment où le mari d’Yvonne s’apprêtait à partir, Yvon lui dit :
— Beau-frère, j’ai envie de vous accompagner, aujourd’hui, dans votre tournée, pour voir du pays, et prendre l’air ?
— Je le veux bien, beau-frère ; mais, à la condition que vous ferez tout comme je vous dirai.
— Je vous promets, beau-frère, de vous obéir en toute chose.
— Écoutez-moi bien, alors : il faudra, d’abord, ne toucher à rien et ne parler qu’à moi seul, quoi que vous voyiez ou entendiez.
— Je vous promets de ne toucher à rien et de ne parler qu’à vous seul.
— C’est bien ; partons, alors.
Et ils partirent de compagnie du Château de Cristal. Ils suivirent d’abord un sentier étroit, où ils ne pouvaient marcher tous les deux de front. Le mari d’Yvonne marchait devant, et Yvon le
suivait de près. Ils arrivèrent ainsi à une grande plaine sablonneuse, aride et brûlée. Et, pourtant, il y avait là des bœufs et des vaches gras et luisants, qui ruminaient tranquillement couchés
sur le sable et qui paraissaient heureux. Cela étonna fort Yvon ; mais, il ne dit mot, pourtant.
Plus loin, ils arrivèrent à une autre plaine où l’herbe était abondante, haute et grasse, et, pourtant, il y avait là des vaches et des bœufs maigres et décharnés, et ils se battaient et
beuglaient à faire pitié. Yvon trouva tout cela bien étrange encore, et il demanda à son beau-frère :
— Que signifie donc ceci, beau-frère ? Jamais je n’ai vu pareille chose : des vaches et des bœufs de bonne mine et luisants de graisse, là où il n’y a que du sable et des pierres, tandis que,
dans cette belle prairie, où ils sont dans l’herbe jusqu’au ventre, vaches et bœufs sont d’une maigreur à faire pitié, et paraissent près de mourir de faim.
— Voici ce que cela signifie, beau-frère. Les vaches et les bœufs gras et luisants, dans la plaine aride et sablonneuse, ce sont les pauvres qui, contents de leur sort et de la condition que Dieu
leur a faite, ne convoitent pas le bien d’autrui ; et les vaches et les bœufs maigres, dans la prairie où ils ont de l’herbe jusqu’au ventre, et qui se battent continuellement et paraissent près
de mourir de faim, ce sont les riches, qui ne sont jamais satisfaits de ce qu’ils ont et cherchent toujours à amasser du bien, aux dépens des autres, se querellant et se battant constamment.
Plus loin, ils virent, au bord d’une rivière, deux arbres qui s’entrechoquaient et se battaient avec tant d’acharnement qu’il en jaillissait au loin des fragments d’écorce et des éclats de bois.
Yvon avait un bâton à la main, et, quand il fut près des deux arbres, il interposa son bâton entre les deux combattants, en leur disant :
— Qu’avez-vous donc à vous maltraiter de la sorte ? Cessez de vous faire du mal, et vivez en paix.
A peine eut-il prononcé ces paroles, qu’il fut étonné de voir les deux arbres se changer en deux hommes, mari et femme, qui lui parlèrent ainsi :
— Notre bénédiction sur vous ! Voici trois cents ans passés que nous nous battions ainsi, avec acharnement, et personne n’avait pitié de nous, ni ne daignait nous adresser la parole. Nous sommes
deux époux qui nous disputions et nous battions constamment, quand nous étions sur la terre, et, pour notre punition, Dieu nous avait condamnés à continuer de nous battre encore ici, jusqu’à ce
que quelque âme charitable eût pitié de nous, et nous adressât une bonne parole. Vous avez mis fin à notre supplice, en agissant et en parlant comme vous l’avez fait, et nous allons, à présent,
au paradis, où nous espérons vous revoir, un jour.
Et les deux époux disparurent aussitôt.
Alors Yvon entendit un vacarme épouvantable, des cris, des imprécations, des hurlements, des grincements de dents, des bruits de chaînes… C’était à glacer le sang dans les veines.
— Que signifie ceci ? demanda-t-il à son beau-frère.
— Ici, nous sommes à l’entrée de l’enfer ; mais, nous ne pouvons pas aller plus loin ensemble, car vous m’avez désobéi. Je vous avais bien recommandé de ne toucher et de n’adresser la parole à
nul autre que moi, durant notre voyage, et vous avez parlé et touché aux deux arbres qui se battaient, au bord de la rivière. Retournez auprès de votre sœur, et moi, je vais continuer ma route.
Je rentrerai à mon heure ordinaire, et alors, je vous mettrai sur le bon chemin pour retourner chez vous. »
Et Yvon s’en retourna au Château de Cristal, seul et tout confus, pendant que son beau-frère continuait sa route.
Quand sa sœur le vit revenir :
— Te voilà déjà de retour, mon frère chéri ? Lui dit-elle.
— Oui, ma sœur chérie, répondit-il, tout triste.
— Et tu reviens seul ?
— Oui, je reviens seul.
— Tu auras, sans doute, désobéi en quelque chose à mon mari ?
— Oui, j’ai parlé et touché à deux arbres qui se battaient avec acharnement, au bord d’une rivière, et alors ton mari m’a dit qu’il fallait m’en retourner au château.
— Et, comme cela, tu ne sais pas où il va ?
— Non, je ne sais pas où il va.
Vers le soir, le mari d’Yvonne rentra, à son heure habituelle, et dit à Yvon :
— Vous m’avez désobéi, beau-frère ; vous avez parlé et touché, malgré ma recommandation et malgré votre promesse de n’en rien faire, et, à présent, il vous faut retourner encore un peu dans votre
pays, pour voir vos parents ; vous reviendrez ici, sans tarder, et ce sera alors pour toujours.
Yvon fit ses adieux à sa sœur. Son beau-frère le mit alors sur le bon chemin pour s’en retourner dans son pays, et lui dit :
— Allez, à présent, sans crainte, et au revoir, car vous reviendrez, sans tarder.
Yvon chemine par la route où l’a mis son beau-frère, un peu triste de s’en retourner ainsi, et rien ne vient le contrarier, durant son voyage. Ce qui l’étonné le plus, c’est qu’il n’a ni faim, ni
soif, ni envie de dormir. A force de marcher, sans jamais s’arrêter, ni de jour ni de nuit, — car il ne se fatiguait pas non plus, — il arrive enfin dans son pays. Il se rend à l’endroit où il
s’attend à retrouver la maison de son père, et est bien étonné d’y trouver une prairie avec des hêtres et des chênes fort vieux.
— C’est pourtant ici, ou je me trompe fort, se disait-il.
Il entre dans une maison, non loin de là, et demande où demeure Iouenn Dagorn, son père.
— Iouenn Dagorn ?… Il n’y a personne de ce nom par ici, lui répond-on.
Cependant un vieillard, qui était assis au foyer, dit :
— J’ai entendu mon grand-père parler d’un Iouenn Dagorn ; mais, il y a bien longtemps qu’il est mort, et ses enfants et les enfants de ses enfants sont également tous morts, et il n’y a plus de
Dagorn dans le pays.
Le pauvre Yvon fut on ne peut plus étonné de tout ce qu’il entendait, et, comme il ne connaissait plus personne|dans le pays et que personne ne le connaissait, il se dit qu’il n’avait plus rien à
y faire, et que le mieux était de suivre ses parents où ils étaient allés. Il se rendit donc au cimetière et vit là leurs tombes, dont quelques-unes dataient déjà de trois cents ans.
Alors, il entra dans l’église, y pria du fond de son coeur, puis mourut sur la place, et alla, sans doute, rejoindre sa sœur, au Château de Cristal.
©Conté par Louis Le Braz, tisserand, à Prat (Côtes d'Armor), novembre 1873.




/image%2F0556039%2F201304%2Fob_ddb0882305bb2aca6481e8ac31231e9e_09cioprm.jpg)
/image%2F0556039%2F201304%2Fob_3766c424a3c143e2ced9b499666a7c8f_druide-bleu1f5cf-cae83.jpg)
/image%2F0556039%2F201304%2Fob_8f31f51ecd2c058db545bcd6989611b1_druides-bretons-lol.jpg)
/image%2F0556039%2F201304%2Fob_21e594_schauenberg-table-des-druides.jpg)
/image%2F0556039%2F201304%2Fob_76ee3436307d61c8f6f02b3b1e540bd3_stonehenge-druides.jpg)
/image%2F0556039%2F201304%2Fob_a2c1b4_le-druide-le-gui-et-sa-serpette-dor.jpg)
/image%2F0556039%2F201304%2Fob_bd1de9d6e600081e9de1be749758133f_lopjg5w4.jpg)
/image%2F0556039%2F201304%2Fob_f72a73964c91e225b257299bdf037c4e_20071223-150053.jpg)